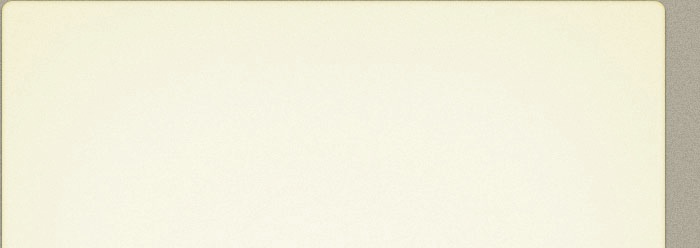Lorsqu'on se penche sur un écrivain comme Julien Gracq chez qui les noms propres des personnages et les lieux prennent une aussi grande place, on est tenté de "traduire", de rechercher les références culturelles, historiques, géographiques, de faire des rapprochements avec certains textes littéraires et par là même d'étudier la grande culture de Gracq, due à son goût profond pour la littérature, pour certaines sciences comme la géographie, due également à ses études universitaires et à ses fréquentations culturelles et artistiques.
Le danger consiste à saisir son œuvre de façon réaliste. L'excès contraire est également redoutable, car il est dangereux de situer son œuvre hors de tout contexte réel. Ce serait d'ailleurs ignorer l'aspiration du surréalisme qui est, entre autre de rechercher, et de mettre en valeur la surréalité du réel. Nous allons voir comment Gracq part du réel, grâce à son sens de l'observation, grâce à son goût pour l'étrange. Le franchissement de la frontière que nous avons constaté entre le réel et l'extraordinaire dans le domaine du style, n'est qu'un reflet du franchissement entre le rêve et la réalité que nous allons découvrir au niveau de la construction d'un roman. Nous prendrons pour exemple Le Rivage des Syrtes, dont certains événements prennent leur élan dans la réalité. Grâce au rapprochement de deux textes de Julien Gracq, nous pourrons constater combien est grand son pouvoir de l'imaginaire et en quoi réside son impact sur le récit. Le Rivage des Syrtes (182) est le plus long des romans de Julien Gracq, à ce jour, il est certainement le plus célèbre, puisqu'il fut l'objet du Prix Goncourt en décembre 1951. Le refus de l'écrivain (183) ne fit qu'augmenter la curiosité du public, sur ce "surréaliste" dont le nom était seulement connu d'un certain public restreint mais amateur de nouveautés et de belle prose (184). Julien Gracq n'est pas seulement "un surréaliste qui écrirait comme un professeur" (185) mais un surréaliste qui a la maîtrise de sa langue et de son imagination pour mieux mettre en lumière les magies d'une aventure surréaliste. Le Rivage des Syrtes classique dans sa présentation en douze chapitres et dans son récit à la première personne, a pu dérouter par sa longueur, par l'attente d'un événement dont nous ne voyons même pas les conséquences. En effet le lecteur reste sur sa faim. L'écrivain est lui-même conscient de ce non-achèvement. "Et Le Rivage des Syrtes jusqu'au dernier chapitre marchait au canon vers une bataille navale qui ne fut jamais livrée" (186).
Le seul acte réel du roman est le franchissement par le navire d'Aldo de la ligne de démarcation entre deux pays en état de guerre froide, depuis trois cents ans : La Seigneurie d'Orsenna et le Farghestan. La division en douze chapitres permet d'imaginer une parabole dont les six premiers chapitres seraient la ligne ascendante et les six derniers, la ligne descendante. L'acte irrémédiable qui est la croisade d'Aldo, se situe au chapitre neuf. Il est la conséquence d'une lente préparation qui pique la curiosité d'Aldo et du lecteur. L'accumulation des faits étranges : l'envoi d'Aldo sur le front des Syrtes, la découverte des cartes que recèle jalousement une pièce de l'amirauté, l'ambiguïté du personnage de l'Amiral Marino, l'investigation d'Aldo dans les ruines de Sagra, le bateau fantôme sur la mer calme et déserte, et enfin le personnage de la Princesse Aldobrandi, Vanessa (187) qui ne paraît pas étrangère à tout ce qui se passe d'inquiétant dans le récit.
Au milieu du roman l'action prend une autre vitesse : Vanessa Aldobrandi amorce le deuxième versant en entraînant Aldo dans l'île de Vezzano (188). Le temps s'accélère, le rythme se précipite, Aldo est sur la pente, mais il n'est pas seul : Vanessa est là, figure énigmatique et attirante. Le peuple de Maremma s'agite car il se souvient de ses grands exploits. L'odeur du soufre s'exhale de St Damase dans la nuit de Noël. Le religieux qui prononce le violent sermon de Noël pousse en quelque sorte Aldo à faire l'acte irrémédiable, il maudit en effet le Sommeil, l'Enlisement. Il semble envoyé de là-bas "il portait la robe blanche des couvents du Sud" (189). Et Aldo pense alors : "Je compris que le temps des prophètes était revenu" (190). Les trois derniers chapitres remettent en ordre la vie à l'amirauté. Le Farghestan se manifeste ouvertement par la visite de son envoyé à Aldo. Vanessa fait bien comprendre à Aldo qu'elle tient plus à Orsenna qu'à lui. Les vieux meurent ou disparaissent, Carlo, Marino. Quant au vieux Danielo il explique à Aldo : "(...) j'ai été pendant trente ans l'homme des livres, eh bien ! je comprenais tout par le menu de la marche de l'histoire : l'enchaînement, la nécessité, le mécanisme des affaires, tout, sauf une chose qui est le grand secret – le secret puéril – pour quoi il faut avoir mis la main à la pâte : la facilité – la facilité déconcertante avec laquelle les choses se font" (191). Danielo n'a pas été la torche qui devait mettre le feu au bûcher que la ville était, mais il le regrette. Aussi Aldo ne doit pas être jugé : "il ne s'agissait pas de bonne ou de mauvaise politique, il s'agissait de répondre à une question - à une question intimidante - à une question que personne encore au monde n'a pu jamais laisser sans réponse, jusqu'à son dernier souffle. - Laquelle ? -"Qui vive ?" dit le vieillard (...) " (192). Ces dernières paroles de Danielo, chef du Gouvernement, donnent un retentissement nouveau à l'action du roman. Aldo s'est lui aussi posé la question en arrivant à Sagra : "Une envie soudaine et inquiétante me prenait de réveiller pour un instant les échos de ces rues, de héler quelques âmes qui vive oubliée dans ce labyrinthe de silence" (193).
On serait tenté de ne voir dans Le Rivage des Syrtes qu'un acte politique d'autant que dans Lettrines (194), Gracq raconte un épisode de la guerre, "la nuit des ivrognes" au cours de laquelle, il a passé avec ses hommes, la ligne des Allemands dans l'allégresse et l'irréalité, précédé de deux éclaireurs ivre-morts. Le rapprochement des deux textes permet de suivre une même construction. On peut se demander si Le Rivage des Syrtes n'aurait pas été inspiré dans ses grandes lignes par cette expérience vécue de la guerre. La question qui clôt Le Rivage des Syrtes termine de même le souvenir autobiographique de la guerre : "Ce fut ma nuit la plus longue et la moins réelle. Vers quatre heures du matin, des pas résonnèrent au devant de nous sur la route, et une voix cria qui vive. Je n'étais pas très sûr que nous étions sauvés " (195). Mais Lettrines date de 1967 et dans les récits antérieurs, on trouve déjà le récit de ces nuits irréelles passées à marcher et à espérer le matin (196). La question du vieux gouverneur "Qui vive ?" semble donner une dimension plus élevée, on se risquerait même à dire, métaphysique. Aldo connaît la réponse. Le lecteur lui, ne peut faire que des suppositions. Cet écho qu'Aldo aurait voulu réveiller dans les ruines de Sagra, il l'entend maintenant ou plutôt il le voit : "(...) mais un écho dur éclairait longuement mon chemin et rebondissait contre les façades, un pas à la fin comblait l'attente de cette nuit vide, et je savais pourquoi désormais le décor était planté" (197). Toute une symbolique littéraire réside dans l'emploi d'éléments qui concernent le décor et dans le rôle de cet écho, de cette lumière vers laquelle tendaient Aldo et derrière lui tout le peuple des Syrtes. Calquer les romans de Gracq sur la réalité est séduisant, mais décevant, on ne peut s'empêcher de constater que la réalité n'est qu'un point de départ, et que l'imagination prend toute sa puissance sous la plume de l'écrivain.
Si les rapprochements entre la vie réelle et le récit du Rivage des Syrtes étaient parfois faciles, il n'en est pas de même pour Au Château d'Argol : en effet le monde poétique d'Argol est à la limite du rêve et de la réalité, du conscient et de l'inconscient.
Il rappelle ces tableaux de peintres surréalistes tels que ceux de Salvador Dali, de Max Ernst, d'Yves Tanguy, de Léonor Fini, de Magritte et de Bellmer où la mer rejoint la terre, où le robot et le mannequin sont les doubles de l'homme, où les ectoplasmes ont une vie propre dans un univers sans dieu et réconcilié avec l'être humain (198). Julien Gracq a revendiqué à l'exemple des surréalistes, les sources du roman noir (Walpole pour son Château d'Otrante, Lewis pour Le Moine )et des écrivains familiers du fantastique (Edgar Poe avec La chute de la Maison Usher, Achim von Arnim, Nerval ). C'est avec un certain humour ou "umour" pour être fidèle à Jacques Vaché (199) que Gracq a inséré dans Argol "le répertoire toujours prenant des châteaux branlants, des sons, et des lumières, des spectres dans la nuit et des rêves" (200). Mais la création littéraire n'est pas le résultat d'un érudit en quête de nouvelles inspirations. Bien au contraire, partant d'un climat de base bien connu, et avoué, le poète se baigne dans les sources même de sa psychologie. L’œuvre est une projection où viennent se réaliser, les souhaits et les désirs : "Le sens de la poésie est proche parente de la divination et d'une façon générale, de l'intuition du voyant" (Novalis - Henri d'Ofterdinguen ).
A l'aide de mots, Gracq, révèle dans Au Château d'Argol un monde inconnu et magique ou par analogie, l'homme déchiffre les lois éternelles. Il n'y a pas eu, nous n'insisterons jamais assez là-dessus intention, ou même conscience de rendre vivants des idées ou des symboles (201). Mais l'écrivain surréaliste ne peut empêcher le lecteur de retrouver ces symboles issus d'un inconscient collectif dans certains cas, et dans le cas de Gracq, d'une certaine culture oubliée telle que celle de l'alchimie. L'acte poétique est un acte d'amour entre l'écrivain et le monde.
C'est pourquoi la poésie sera purement subjective. Chaque poète puisera dans son moi intérieur. La mémoire, le rêve sont des puits d'images où chaque écrivain, selon sa formation, selon son tempérament, vient se rafraîchir.
Nos entretiens avec Julien Gracq nous ont permis de constater combien il était passionné par la géographie ; souvent même d'un point de vue technique. Sa formation de géographe l'a familiarisé avec la géographie physique, l'étude des roches, le comportement des animaux. Gracq a les yeux ouverts sur l'extérieur, les formes, les couleurs, les paysages, les mondes su végétal et du minéral (202). Ce qu'il décrit est parfois si proche de la réalité qu'il est facile de reconnaître le chemin qu'il suit au cours de ses descriptions (203). La psychologie l'intéresse peu. En tant que surréaliste il la désavoue même. De l'être humain, il ne lui reste plus que, lui-même face à lui-même. On comprend dès lors que la mémoire de l'écrivain ait fait jaillir certaines images, certains concepts, propres à l'alchimie et à l'ésotérisme (204). L'homme individuel étudie ses rapports avec l'univers, par l'intermédiaire des métaux, donc du matériel, du formel. Dieu est banni de l’œuvre de Gracq aussi bien que de celle des surréalistes. Leur monde est matériel, mais sensible aux mystères de la destinée humaine. Et dans un monde créateur d'objets, vient se mirer l'esprit en peine de son secret. L'imaginaire Gracquien fonctionne selon des constantes et des structures qui lui sont propres. L'impulsion est généralement donnée à partir d'une rêverie autour de mots, de noms propres, dont l'aspect musical et lointain rappelle à l'écrivain certains souvenirs de géographie, d'histoire ou de littérature (205). Autour de ce mot magique, que ce soit Argol, les Syrtes, Mona, Vanessa, Martinengo, viennent se greffer tout un climat, une atmosphère spécifique. Julien Gracq choisit de préférence des lieux qu'il ne connaît pas ou presque (206), mais auxquels il n'est pas spécialement attaché par un lien affectif : (il avait vu le nom d'Argol (207) dans un dépliant d'autobus et n'avait jamais visité les Syrtes). Lorsque les lieux décrits sont réels, Julien Gracq éprouve le besoin de les transformer comme "Monthermé" (208) dans les Ardennes qui deviendra "Moriarmé" dans Un Balcon en Forêt. Le climat qui se crée autour du mot répond à certaines constantes : l'univers gracquien aussi visuel qu'auditif est fait d'une nature souvent très belle ; la mer, l'océan, la forêt vivante et secrète y ont une place privilégiée. On imagine mal un récit gracquien se déroulant à la ville (209). Gracq aime la campagne, l'air pur, les grandes étendues que l'on découvre du haut d'une falaise (210), ou d'une montagne, que ce soit Montségur (211) ou la chapelle de Mortain (212). Il est curieux de constater que l'espèce animale anime rarement le paysage gracquien exception faite nous le verrons pour "La Route" (213). Profondément enraciné dans cet univers qui a tous les charmes et le mystère du monde à sa création, l'homme vit au rythme des saisons, d'une manière quasi végétative (214) à l'écoute de l'étrange. Le héros gracquien attend des choses simples, naturelles, l'amour, la mort, la connaissance qui pour d'autres êtres passeraient inaperçues ; mais pour lui, les circonstances, l'attente rendent l'acte, "l'événement" unique, extatique, en lui donnant une signification autre.
Mais à travers ces moments privilégiés de la connaissance, de l'amour, de la communion avec la nature, se devine le principal mobile de l’œuvre : le temps "(...) pour moi, quelque chose qui fait surface : l'écoulement du temps (...) " (215). Nous verrons en détail (216) combien le temps qui passe est l'un des fils conducteurs de l'imaginaire Gracquien. Ces circonstances, cette structure de l'imaginaire gracquien nous allons voir, tout au cours de notre étude comment elles fonctionnent parallèlement à des schémas tirés d'un fond culturel et traditionnel.
182. Gracq, Le Rivage des Syrtes, Paris: Corti, 1951.
183. Voir supra, note 3.
184. Voir supra, note 1, article de Max Paul Fouchet.
185. Jugement avancé par Maurice Nadeau (J.-L. Leutrat, Gracq, p. 10).
186. Gracq, Lettrines, p. 28-29.
187. Au sujet de Vanessa, consulter: Joseph Place, « Vanessa Aldobrandi », Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, n°2 (1952), p. 110- 115.
188. Au sujet de Vezzano, consulter: Joseph Place « L’île de Vezzano » , Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, n°1 (1952); p. 55- 56.
189. Gracq, Le rivage des Syrtes, p. 175.
190. Ibid., p. 176.
191. Ibid., p. 308.,
192. Ibid., p. 321.,
193. Ibid., p. 71.,
194. J. Gracq, Lettrines, p. 120- 126.
195. Ibid., p. 126.,
196. Gracq, Au château d'Argol, chapitre 8 : "l'allée", p. 129 et sq. – Un beau ténébreux, p. 16- 25 : « Et c’est vrai que j’aurais voulu marcher jusqu’au matin ».
197. Le rivage des Syrtes, p.322. Ceci est à rapprocher de Nadja de Breton : Livre de poche n° 1233, p. 169 « … le cri toujours pathétique de “qui vive ?” Qui vive ? Est-ce vous Nadja ? Est-il vrai que l’au-delà, tout l’au-delà soit dans cette vie ? Je ne vous entends pas. Qui vive ? Est-ce moi seul ? Est-ce moi-même ? ».
198. Au château d'Argol, "Avis au lecteur" p. 10.
199. J. Gracq, André Breton, p. 204.
200. Voir supra, note 97. 129.
201. Au château d'Argol, "Avis au lecteur" p.10.
202. Texte inédit de J. Gracq, Chemins (Cahiers de l'herne, ), p. 181 : « Entre 1942 et 1946 j’ai longuement parcouru à pied la Basse-Normandie : je travaillais à une thèse de géographie physique ». J. Gracq nous a dit avoir fait également son mémoire de maîtrise sur un sujet de géographie physique qui concernait son pays natal, les Mauges.
203. A propos de La presqu’ïle voici ce qu’écrit Xavier-Olivier Guichard, Un chemin tranquille. Paris, Flamarion, 1975, p.44 : « Mon père était né à Saint-Nazaire, et je connaissais chaque paysage de la presqu’île Guérandaise. J’y suis toujours et j’y ai appris de nouveaux chemins. Julien Gracq les connaît presque aussi bien. Il les a fait suivre au héros de sa Presqu’île. J’étais à l’Education Nationale quand il l’a publié et, puisqu’il était professeur, je lui ai demandé de venir me voir, et ensemble, nous avons reconstitué ses itinéraires. Je les avais reconnus sous leurs noms d’emprunt, à travers son pointillisme poétique. ».
204. Cf. supra, chapitre 3.
205. Voir supra, note 70, Julien Gracq a bien voulu ajouter un supplément à ce sujet à propos du poème en prose "Au bord du beau Bendèse" de Liberté grande, p. 77 dont l’édition pré-originale date de 1946 (Les quatre vents, n° 4). Le titre, si étrange, vient d’une page du poète anglais Thomas More (1780- 1852). Dans son recueil de nouvelles orientales en vers reliées par un conte en prose : Le paradis et la peri, (1817), il est question du fleuve de mythologie indienne le Bendème.
206. Eléments pour une Biographie (Les cahiers de l'Herne, ), p. 182 : « A la fin du mois de septembre Henri Queffélec lui révèle la Bretagne : « C’est alors que j’ai découvert le nom d’Argol, lu dans un horaire d’autocars ».
207. (Cahiers de l’Herne, p. 214, ) : « … je suis foncièrement allergique au réalisme. Il m’est impossible, je crois… de raconter une histoire en la situant dans le cadre même où se trouvent les souvenirs auxquels je fais appel pour raconter cette histoire. J’ai besoin d’un recul, d’une transposition… Il m’est très difficile d’avoir recours à des choses vues et de localiser une histoire dans une région où j’ai vécu… ». p. 216 : « Je suis allé jusqu’aux Hauts-Buttés, prés de la frontière belge et je suis revenu à pied à Monthermé où j’ai pris le train » Ces Hauts-Buttés n’ont-ils pas donné les Hautes Falizes ?
208. (Cahiers de l'Herne,), p. 219 : « je fais peut-être un peu exception, parce que la littérature actuelle est une littérature urbaine : le cadre c’est la ville et la ville n’a pas de saisons. Prenons un exemple : les romans de Sartre qui sont peut-être ce qu’il y a de plus connu en littérature depuis la guerre. Le cadre, c’est la ville, et le lieu, c’est le café. Le lieu des rencontres où l’on parle. La nature disparaît. Je me sens alors tout à fait dépaysé. J’habite Paris, mais je me sens par affinité campagnard, non urbain … ».
209. A Sion-sur-Océan par exemple où il passe ses vacances.,
210. Lettrines, p. 62- 65.
211. Cahiers de l'Herne, p. 383 : « 1942-46 : assistant de géographie à la Faculté des Lettres de Caen. C’est alors qu’il fait la découverte de la chapelle dominant Mortain où il passe des heures » ; Préférences, p. 64 : « De pareils endroits m’attirent certainement, en rêve ou en réalité ; je m’en détache difficilement. Moins encore les sommets de montagne, d’où la vue est presque toujours bornée, que les falaises, les marches d’escalier qui découvrent un vaste pays plat, ou encore les très hautes tours ; l’un des plus beaux panorama de ce genre est pour moi celui d’une chapelle qui domine Mortain, en Normandie, et où j’ai passé des heures. Mais je dois dire qu’en même temps que cette situation, imaginaire ou réelle me captive violemment, elle me paraît toujours douée d’une suggestion maléfique, et je crois qu’ici se retrouve un très vieux pli de la sensibilité collective ; le sentiment qu’au fond c’est toujours le démon qui nous ravit sur la montagne ».
212. Voir Infra, chapitre 11
213. Les Cahiers de l'Herne: p. 219. « … et j’ai hasardé le mot de plante pour définir l’homme : je ne l’ai d’ailleurs pas inventé. Ce n’est pas seulement un être de relations sociales. Je dis que c’est aussi une plante humaine, et je veux dire par là qu’il est sensible, comme une plante enracinée dans un sol, au climat, au temps et à la saison. Personnellement je suis d’une manière extrêmement nette. L’écoulement, le passage d’une saison à l’autre qui est presque tout ce qui se passe dans le livre, ce sont pour moi des événements importants. Si on ne tient pas compte de cette idée de la plante humaine, il est évident qu’il ne se passe rien dans le livre. Si on n’admet pas que l’homme est constamment influencé par la nature, la terre, les saisons, le sol, la forêt, il est tout à fait vide d’événements, et même de contenu conventionnel, mais pour moi, c’est là aussi un contenu très important. En fait même je crois que c’est pratiquement le seul contenu de mes livres… » 11.
214. Les Cahiers de l'Herne, : p.219 ; cf. Le rivage des Syrtes, p. 295 : «… l’impression… me venait parfois - … - … que le temps même coulait, coulait comme un sang, coulait maintenant en torrent à travers les rues. Et on eût dit que chacun y buvait son espoir et sa force comme dans le premier coup de vent de la haute mer… ».
215. Voir chapitre 10, Le Temps.
216. Gracq, La presq'île, Paris: Corti, 70.